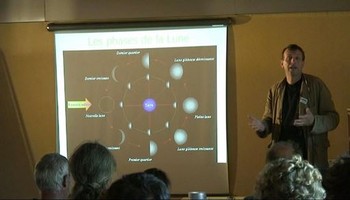Vintage Books, 2015 (traduction française chez Albin Michel, 2017). Cette « brève histoire du futur » comme stipulé dans le sous-titre du livre commence en réalité à la p. 327 avec la troisième partie. Tout ce qui précède traite de l’histoire passée, ce qui laisse le lecteur sur sa faim, c’est le moins qu’on puisse dire. Il faut résister pendant plus de trois cents pages au fil desquelles l’histoire mondiale se trouve pour le moins arbitrairement résumée et souvent maltraitée pour en arriver enfin au sujet principal.
Heureusement, cette troisième partie propose une analyse plus fine et donc plus intéressante. On comprend, très tard – en fait dans les toutes dernières pages de l’ouvrage – où voulait en venir l’auteur : quelques questions simples que l’on se pose d’emblée lorsqu’on s’interroge à propos de l’avenir et de certaines directions prises par la société actuelle, c’est-à-dire la possible compétition entre Intelligence Artificielle et humanité, ainsi que la nature profonde de la conscience dont il nous est asséné à longueur de chapitres qu’elle s’assimile à un algorithme complexe, une proposition qui n’est relativisée que dans les toutes dernières lignes du texte. Bref, vous l’aurez compris, je n’en recommande pas la lecture. Je vais cependant étayer cet avis.
Il est difficile de critiquer un best-seller, surtout lorsqu’on s’inscrit à rebours de l’opinion générale. Le titre de l’ouvrage, Homo deus, se réfère à la transition avec l’humain actuel, Homo sapiens, titre du précédent livre de Harari, que l’auteur annonce texto comme une « mise à jour » (upgrade, re-engineer) en adoptant de manière pas du tout innocente le langage de l’informatique. Pour lui, donc, cette mutation relève d’une assimilation de l’humain à l’IA, thèse qu’il soutiendra jusqu’à la toute fin du livre et présente comme l’opinion majoritaire en biologie contemporaine, ce qui est heureusement loin d’être le cas. Cette transition vers l’IA, c’est ce que Harari considère comme l’accès à la divinité, du moins le laisse-t-il penser. On peut avoir dès le début l’intuition qu’il s’agit d’une provocation de sa part, mais il faut arriver 450 pages plus loin avant d’en avoir la confirmation, et nombre de lecteurs auront bien avant cela fini par y croire ou par jeter le livre.
La mobilisation régulière des dogmes humanistes, effectivement déterminants dans la société et dans les sciences contemporaines, ne fait pas vraiment l’objet d’analyses comme ont déjà pu en proposer de nombreux auteurs, philosophes, sociologues, anthropologues, historiens des sciences, etc. L’idée d’une sacralité de la vie humaine est évoquée, mais jamais n’est posée la question pourtant fondamentale de savoir pourquoi cette sacralité n’a pas depuis été étendue à la vie en général et est restée comme cristallisée sur l’humain dans la pensée humaniste, alors même qu’actuellement, cette tendance est largement bousculée par de nombreux mouvements philosophiques, écologiques, voire politiques. Les choses bougent, dans un tout autre sens que ce qui a occupé la réflexion d’Harari – heureusement, on ne l’a pas attendu pour cela ! On ne l’a pas attendu non plus pour critiquer l’humanisme et surtout l’individualisme qui en a découlé, ni pour parler d’une « religion du moi » (Durkheim, parmi bien d’autres qu’il ne cite pas), mais pas non plus pour relativiser l’assimilation de l’humanisme à une religion, à un « théisme de l’homme ».
Harari a le sens de la formule – des formules faciles et répétitives. Par exemple, il veut nous convaincre que l’évolution humaine, jusqu’à présent, a visé la résolution de la triade « famine, épidémies, guerres », que c’est chose faite et que, désormais, l’objectif est « immortalité, bonheur (bliss, qui correspond à un épanouissement spirituel avant tout) et divinité », et donc que l’accès à ces états dépendrait d’une assimilation de l’esprit humain à l’IA en passant par la mise en interface du corps et du numérique. C’est le point de vue des transhumanistes, mais il paraît quand même plus qu’audacieux d’affirmer que c’est également celui qui régit les sciences contemporaines et que l’on va imposer aux masses dans les prochaines décennies.
Certes, l’auteur prend quelques précautions (pp.64-65 de l’édition paperback anglaise), mais cela ne suffit pas à laisser penser que tel n’est pas son propre crédo tant il va le répéter des dizaines de fois et s’en servir comme unique prisme d’interprétation jusqu’à la fin du livre. Il se défend de faire de la politique, mais il est clair que toute façon de présenter les choses en de tels domaines exprime un positionnement politique, et il est révélateur à cet égard de repérer ici et là dans le texte ce qu’il considère comme étant l’issue la plus probable. Encore une fois, cela ne me l’a pas rendu sympathique, car on ne peut voir dans de telles affirmations que l’esquisse d’un certain cadre de fatalité. En particulier, il annonce que les performances de l’IA vont dépasser celles de l’humain, mais il le fait sans aborder à aucun moment la question des différences ontologiques entre le calcul numérique et l’expérience vivante. Son assimilation de l’un à l’autre et le basculement vers un humain numériquement augmenté qui serait assimilable à une divinité s’avère par conséquent totalement gratuite. Harari truffe son texte de raccourcis absolument erronés, comme l’affirmation que l’humanité serait la seule espèce terrestre capable de coopérer à grande échelle, celle que la mort serait un arrêt du flux d’échange d’informations, celle que la vie des individus dans la société moderne ne tourne qu’autour de la quête de pouvoir – comme si l’idée de quête spirituelle avait disparu, alors même qu’elle s’expose sur tous les étals de librairies, les blogs et l’offre de stages de développement personnel – et, ajoutons-le, alors même que c’est ce qui a permis à ses propres livres de se vendre… Il ne comprend rien à la provocation dans l’art de Duchamp, ni aux gestes héroïques et aux mythologies.
Il déclare que la modernité a chassé les anges et autres créatures spirituelles de nos vies alors qu’on n’a jamais tant recensé d’intérêt pour la communication avec les au-delà et les entités qui les peuplent. Il donne à fond et sans aucune nuance dans le matérialisme dualiste (« humans are ‘dividuals’ ») en considérant, suivant là certains neurobiologistes et quelques néodarwinistes, que l’activité cérébrale abolit toute notion de libre arbitre (pp. 329 & 354). Il envisage ainsi que l’accumulation de données numériques puisse être l’unique façon raisonnable de connaître les individus – un comble, encore une fois, dans un monde qui s’adonne déjà autant au développement personnel. Encore une fois, ce n’est pas – et loin de là – la seule manière d’interpréter les découvertes récentes en neurologie, et la tendance est bien davantage à envisager la conscience comme une propriété émergente du cerveau, et même – on y viendra – de la globalité de l’organisme, plutôt que comme l’activité conduite par un algorithme auquel l’individu pourrait être réduit. Fort de cette conviction, Harari se laisse aller, bien qu’il s’en soit défendu, à des prédictions aux relents de darwinisme social que l’on ne peut qu’espérer ne jamais voir s’accomplir. Notamment, il valide le fait que l’économie de marché dirige le monde, non seulement sur le plan économique, mais comme si tous les autres aspects de l’existence humaine se résumaient à ce que l’on consomme.
Il n’y a qu’à regarder dans la rue ces temps-ci pour constater que tel n’est pas le cas : les humains se bougent pour s’opposer à cette tendance consumériste, même si des solutions efficaces à grande échelle restent à mettre en place. Harari prétend avoir écrit un livre de remise en question, mais une véritable remise en question aurait passé par une analyse contradictoire et un exposé de l’immense panel de propositions qui existent déjà. Dans son livre, rien de tout cela. L’ouvrage ne peut par conséquent passer que pour un constat de collapsologie, un de plus, qui ne fait pas avancer les choses. Toutefois, dans la troisième partie, il fait preuve d’un peu plus d’objectivité et relève avec pertinence l’influence souvent occulte et pernicieuse des technologies de l’information sur l’économie néolibérale (p. 364 et suiv.).
À la suite, il propose une meilleure mise en perspective de la question de la concurrence entre machines et humains dans un proche avenir (robotisation), mais élude le cœur du sujet, à savoir que les humains sont capables d’inventer d’autres modes d’activité que le travail en usine ou au bureau, ainsi que les problématiques en lien avec la santé que cette transition entrainera. Il ne se demande pas non plus si ces profonds changements sociétaux ne seront pas la source de nouveaux mouvements religieux, alors que c’est plus ou moins déjà le cas. Il alerte sur les conséquences qu’aura rapidement, dans la perspective qu’il présente, la gestion de l’humain par l’IA, débouchant sur une manipulation de plus en plus importante de la vie des individus par une administration numérique dont l’unique objectif resterait l’utilitarisme neutre. Or on sait déjà par la littérature de Science Fiction que la conclusion logique de ce processus est que la destruction de toute vie sera l’ultime décision de la machine.
Harari situe bien la candeur qu’il y a à abandonner gratuitement des données personnelles aux gestionnaires de réseaux sociaux – qui vont les exploiter à outrance – pour le simple plaisir de converser, ce que l’on peut aussi faire directement avec ses voisins de palier. Il voit juste également en soulignant que, fort vraisemblablement, le monde se dirige vers une société à double vitesse entre des humains pouvant bénéficier de ces technologies plus ou moins transhumanistes – dont toutes ne doivent pas forcement être rejetées d’emblée – et d’autres qui ne pourront pas se les offrir ou ne voudront pas y souscrire. Harari aborde évidemment la question de l’eugénisme et même, c’est inattendu, mais bienvenu, l’augmentation chimique de l’humain (pp. 424-425) qui est partout répandue, avant même que ne soit devenue facilement disponible celle numérique.
Encore une fois, ce clivage social est déjà entamé. Nonobstant, il n’est pas encore clair laquelle de ces tendances méritera le qualificatif d’humain, de superhumain, ou autre. L’auteur prophétise l’émergence d’une religion « dataïste » (de data, données informatiques) dont le dieu serait une sorte d’Internet global (Internet-of-All-Things), mais il néglige le potentiel religieux de certains mouvements écologistes tout comme celui des réactionnaires, question qui n’est quasiment jamais abordée bien qu’elle soit de brûlante actualité. D’ailleurs, l’évocation qu’Harari fait de l’information gagnerait très nettement à être illustrée par les plus récentes théories de l’information qui relient la physique à l’informatique, un domaine déterminant dans les sciences actuelles dont il s’inspire sans clairement s’expliquer. Son modèle est entièrement quantitatif, et non qualitatif, or c’est bien là, encore et toujours, que se niche l’obscurantisme matérialiste. Ce modèle cognitiviste fondé sur la statistique des données ne tient par définition compte que du passé et pas du tout de la grande plasticité des réseaux de connexions cérébraux, or il a été discuté dans de nombreux autres contextes le fait que l’humain n’est pas réductible à une perception linéaire de la temporalité. Ce n’est finalement qu’à la page 458, cinq pages avant la fin du livre, qu’Harari se lance dans un questionnement de ce point de vue extrêmement restrictif, ce qui lui laisse à peine la place de poser quelques questions sans chercher à y répondre, alors que nombre d’auteurs s’y sont déjà consacré avant lui. Bref, quelle frustration pour un auteur qui prétend élargir notre horizon ! M. Harari, nous ne voulons ni de vos lendemains, ni de vos angoisses ! Écrivez des romans de Science Fiction tant que vous voulez, vous pourrez ainsi explorer les terrains qui vous intéressent sans jouer les prédicateurs, mais ne cherchez plus à édifier les autres en publiant une énième liste des problèmes de l’humanité ; vous n’êtes pas constructif. Si par malheur vous avez raison, vous pourrez toujours nous prendre alors de haut en disant que vous nous aviez prévenus.
Source: La lettre du crocodile