Le cinéma : voilement et dévoilement
Image et magie forment une anagramme. Cette constatation ne relève pas d’une pirouette verbale à la mode de la langue des oiseaux, mais bien d’une réalité historique : on doit, en 1671, la première lanterne magique au père jésuite Athanasius Kircher. Sa description se nommait ainsi : Ars magnae lucis et umbrae (Grand Art de la lumière et de l’ombre) et les premiers utilisateurs de ce jeu de projection, de diffractions, d’ombres et de lumières, ancêtre du futur cinématographe, furent les magiciens…
abonnez-vous pour un accès à tout le catalogue !
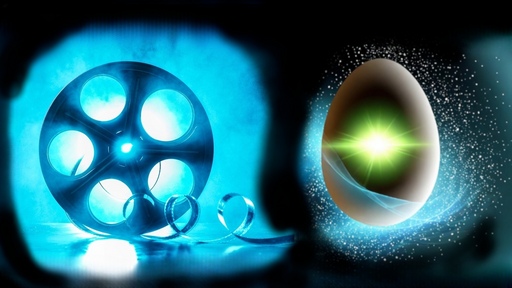
Regarder un film nous plonge dans un état de réceptivité au cours duquel nombre de nos sens sont sollicités. Une quasi synesthésie. L’écran hypnotique réfléchit nos émotions profondes et devient le miroir de nos projections psychiques. A l’instar du film Orphée de Jean Cocteau (1950), ce miroir matérialise, en potentialité, une bascule entre la réalité ordinaire et le monde intelligible. Un franchissement vers le monde des archétypes.


« Le cinéma dévoile le rapport secret entre les êtres et les choses » (Jean Epstein, cinéaste et kabbaliste)
Yann Calvet interroge ici les ressorts herméneutiques des premiers films tournés dans les années 20. Dans le prolongement de l'exacerbation des sentiments propre au romantisme et à l’impressionnisme, le cinéma ne constituerait il pas, lui aussi, un Art Total dont l'ambition serait de dévoiler, de manière poétique, les mystères de la création ? Une sorte de défi à l’affirmation d’Héraclite (VIe s avant J.-C.) selon laquelle « la nature aime à se cacher » ?
Puisant ses références dans la philosophie antique (Le Miroir d’Isis de Pierre Hadot), le Nouveau Testament, (Corinthiens 1 Co 13), la correspondance entre Joséphin Péladan et Stanislas de Guaita, la lyrosophie développée par Jean Epstein, ou encore les liens d’Odilon Redon avec les occultistes de son temps, Yann Calvet analyse ici cette articulation entre visible et invisible : ce qu’il est donné de voir et aussi d'entendre sur cette toile tendue que constitue l’écran. Ecran, et voile à la fois, qu'il s'agit de lever pour voir ce qu'il s’y passe « derrière »…
Un exposé qui s'inscrit et complète nos quinze films, enregistrés à Vézelay lors du séminaire de Françoise Bonardel, intitulé « Expérience visionnaire et transformation intérieure ».
-----------------------------
Exposé issu du colloque : Raconter et montrer l'Invisible à la croisée de la littérature, des arts de la scène et du cinéma (1850-1930), août 2024. Direction scientifique : Julie Anselmini, Yann Calvet et José Moure. Réalisé avec le soutien de :
• UFR "Humanités et Sciences Sociales" (HSS) | Université de Caen Normandie
• Laboratoire "Lettres, Arts du Spectacle, Langues Romanes" (LASLAR - UR 4256) | Université de Caen Normandie
• Institut "Arts Créations Théories Esthétique" (ACTE - UR 7539) | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
• Caen la mer Normandie

